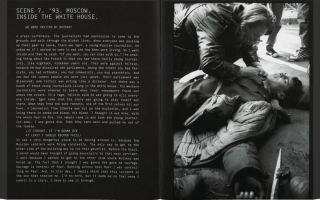C'est un monstre inconnu qui serpente sur la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Ses dimensions donnent le tournis: 3.200 kilomètres de barbelés seulement interrompus de portions en briques, flanqués de 60.000 à 80.000 soldats indiens qui montent la garde quotidiennement, pour un contingent total de 200.000 soldats entièrement dédiés à cette tâche. Côté bangladais, ils sont 70.000. Commencé en 1993, ce mur a mis 10 ans à s'élever, pour un coût record de 4 milliards de dollars.
Mais la statistique la plus criante, et c'est un chiffre officiel, c'est le nombre de morts que l'on retrouve à ses abords: un tous les cinq jours, depuis dix ans. Voici le plus meurtrier de tous les murs-frontières du monde.
Cette ceinture circonscrit presque totalement le Bangladesh, qui ressemble à une grande enclave à l'est de l'Inde. D'un côté, une superpuissance naissante, et de l'autre, le pays le plus pauvre d'Asie. Au milieu de cette frontière, des villages pris dans des zones interdites d'accès pour les gens de l'extérieur. La mission de la Border Security Force (BSF) indienne est d'endiguer l'immigration illégale et le commerce clandestin. Les soldats ont l'ordre de tirer à vue.
L'Inde est un eldorado pour le Bangladesh. En 2013, le PIB de l'un culminait à 1.400 dollars, contre 899 dollars de l'autre côté de la frontière. Et ces dernières années, à cause des catastrophes naturelles à répétition sur le territoire bangladais, les migrants économiques se doublent des migrants climatiques. Le photographe Gaël Turine est le premier à documenter cet endroit presque inaccessible. Il livre à BFMTV.com le récit de son reportage inédit.
Qu'est-ce qui fait de ce mur un symbole à vos yeux? Je voulais travailler sur la notion de séparation entre les peuples. J’avais décidé d’écarter toute une série de murs dont on parle beaucoup, et j'ai trouvé celui-là grâce à une vidéo dans laquelle on voit un jeune homme torturé par des soldats indiens. Après de plus amples recherches, il m’a semblé évident que ce mur concentrait tous les aspects de la séparation: le contexte géographique, environnemental, politique, religieux, les raisons comme les conséquences sur la population... tout y était".
Pourquoi personne ne connaît l'existence de ce mur? Non seulement on ne connaît pas son existence à l'étranger, mais on ne la connaît pas non plus en Inde. J’ai rencontré énormément de gens là-bas qui n'en avaient jamais entendu parler. C'était le cas notamment de la rédactrice en chef du bureau indien de la BBC, ou du correspondant du Stern... Parce qu'ici les ministères des Affaires internes et des Affaires étrangères s’entendent sur la nécessité de taire son existence. Le Bangladesh, complètement dépendant de l'Inde, n'a pas d'autre choix que de suivre cette politique. Quand j’ai commencé, j'ai trouvé des photographes du Bangladesh qui avaient tenté, en vain, d'y faire un reportage. Ils m’ont dit que c'était impossible. Tous les journalistes qui ont essayé d'en parler ont eu des problèmes".
Comment avez-vous fait pour réussir là où des journalistes locaux ont échoué? Le mur est entouré de grandes zones interdites où les soldats patrouillent. Côte bangladais, il est impossible d’approcher le mur car les soldats indiens tirent sur tout ce qui bouge. On ne peut qu'observer de loin à travers la végétation. En plus, dans les villages qui se situent au cœur de ces zones, il y a des indics civils qui renseignent les patrouilles, il règne une grande paranoïa.Alors je suis entré en contact avec une ONG qui a un réseau de "fact finders", des informateurs locaux qui les renseignent. Le réseau a été constitué pour l'écriture d'un rapport sur le mur à destination de Human Rights Watch. L'ONG m'a mis en relation avec ces personnes, et ce sont elles qui m'ont guidé. Seul, comme photojournaliste, je ne serais arrivé à rien".
Cela demande beaucoup d’efforts pour passer dans la zone interdite. Il faut emprunter des petits chemins à pied, à dos d'âne, à vélo, faire des détours... Là, il faut trouver le chef de village et le convaincre de me faire rencontrer des villageois. Puis les convaincre, eux, de témoigner en leur expliquant ce que je fais et pourquoi c'est important. Enfin repartir, ne jamais passer la nuit en zone interdite. Et ne jamais passer plus de deux nuits au même endroit. Les villageois étaient très enclins à témoigner, je n’ai eu que très peu de refus. Pourtant, ils étaient aussi tout à fait conscients des risques, cela pouvait se savoir et arriver aux oreilles des hommes de la caserne du coin.
En fait, le temps de prise de vue, ce n'est que 3% à 4% de ce travail. Le reste du temps, je l'ai passé à trouver des infos, trouver le bon chemin, jouer à cache-cache avec les patrouilles... Chaque prise de vue est la cerise sur le gâteau, l'accomplissement de toute une préparation qui m'a permis de raconter l’histoire".
Oui, trois fois, mais ça s'est bien passé pour moi. Ce qui m’a sauvé, c'est que je n’avais pas du tout l’air d’un photographe. Je me baladais en tongs, en shorts et avec un seul petit boîtier Leica, et je disais que je me baladais, que je voulais voir ce mur. Dans ces régions il y avait soit-disant Internet par satellite, mais ça ne marchait jamais. Heureusement pour moi, on n'a pas pu googler mon nom. Sinon c’était fini, j'étais expulsé."
Mais lors d'une de ces arrestations, l'un de mes accompagnateurs, qui était journaliste par ailleurs, a écopé d'une suspension de salaire de trois mois après que le ministère a appelé son directeur. C'est aussi pour ça que j'ai pu faire ce reportage: au pire, je risquais l'exclusion. Les locaux, eux, dix ans de prison".
"Le mur et la peur" de Gaël Turine chez Actes Sud, collection Photopoche.